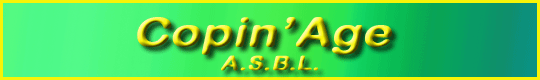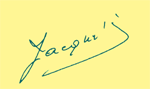Dernière
mise à jour :
25/11/04
|

La Place Flagey et le cimetière de Laeken
Sauvenière, fin août 2004.
Bonjour Copinageois et Copinageoises,
Notre sortie mensuelle était consacrée à la découverte de deux sites de la capitale. Le premier
La Place Flagey et son célèbre « Paquebot »
Au XIXe siècle, le quartier Flagey était très rural. Les étangs comprenaient quatre bassins dont le dernier recouvrait une partie de la place.
Léopold II dans son projet visionnaire décida d’aménager ce quartier afin d’en faire un point névralgique à Bruxelles. On perça la Chaussée d’Ixelles afin de relier la cuvette à l’Avenue Louise. De même, il assécha deux des étangs et recouvrit le Maelbeek de la même façon qu’il avait déjà voûté la Senne. La place Flagey, anciennement nommée place Sainte Croix, vit le jour fin du XIXe siècle.
Avant d’en arriver à la radio et la télévision actuelles, il a bien sûr fallu passer bien des étapes.
En premier lieu, Marconi a mis au point le morse, système de télégraphe utilisant un alphabet conventionnel par points et par traits, et subséquemment, l’appareil servant à la transmission et à la réception de ces signaux.
Vient ensuite l’invention du poste à galènes.
En 1923, Radio Belgique installe ses premières installations à la rue de Stassart à Bruxelles et Théo Fleischmann présente le premier journal parlé en 1926.
En 1930, la radiodiffusion décide de construire un bâtiment. Le problème de l’emplacement se pose alors. En effet, il faut réunir plusieurs conditions qui ne sont pas très faciles pour une ville : il faut surtout une certaine hauteur afin que le relais des ondes soit assuré, il ne faut pas que le quartier soit trop urbanisé, ceci pour limiter les expropriations.
Le site de la Place Sainte Croix est choisi : le problème de la hauteur se résoudra par l’installation d’un relais sur le Palais de Justice.
Technique et architecture
Un concours est organisé. Le problème majeur consiste à allier l’aspect technique de l’acoustique à l’esthétique architecturale. Personne ne gagnera, ce qui obligera l’organisation d’un second concours.
C’est alors que Joseph Diongre qui a déjà réalisé l’église de Molenbeek et la maison communale de Woluwé a la judicieuse idée de s’associer avec un ingénieur du son, ce qui lui vaudra de gagner le concours.
Il solutionnera l’acoustique par la construction de deux tours en brique, dans lesquelles seront situés les studios et autour desquelles il construira un « mur de béton » qui accueillera les bureaux administratifs.
Le style architectural qui prévaut à l’époque est l’Art Déco. L’horizontalité des lignes, l’utilisation de la brique jaune, l’extraordinaire jeu de volumes, la géométrie des formes, la non utilisation des angles droits…, tout cela se retrouve partout dans le bâtiment.
On a souvent associé le bâtiment de l’ I.N.R. à un paquebot. Il faut savoir qu’à l’époque des années ’30, les transatlantiques ont la cote auprès de la bourgeoisie et la machinerie va énormément influencer les architectes de l’époque. De plus, par sa situation à proximité des étangs d’Ixelles, il était très tentant de s’inspirer de ces navires pour la construction de la « maison de la Radio ». Partout l’on retrouve des balustrades, des grandes baies vitrées, une division en différents ponts, un espace et un mobilier très similaires à celui des transatlantiques.
Le bâtiment a été achevé en 1938. Dès ce moment, la radio s’y installa. En 1953, ce fut au tour de la télévision.
A partir de 1974, le déménagement vers les studios Reyers fut entamé. L’espace était devenu trop petit pour accueillir tout le monde et d’autre part, le bâtiment était construit avec de l’amiante, ce qui le rendait insalubre.
Les derniers services désertent le navire en 1994. C’est alors devenu un squat avant que l’Unesco ne le classe et que Philippe Samyn n’organise sa restauration en 1998.
Le bâtiment fut ré inauguré en 2002.
Visite des studios
Studio n° 1
La première chose à savoir est que le public qui assistait aux enregistrements n’était pas spécialement mélomane mais plutôt réquisitionné pour les applaudissements. En ce qui concerne l’acoustique, le système de colonnes est ici tout à fait intéressant. En effet, chaque colonne présente 3 faces en bois recouvertes de grillage et de bois, (matériau utilisé pour repousser le son, l’autre pour l’attirer). Le régisseur faisant tourner les colonnes en fonction de l’intensité du son souhaitée.
Le désamiantage fut ici le plus important puisque toutes les colonnes présentaient ce matériau. Les sièges ont été refaits à l’identique et le parquet est en marqueterie d’origine.
Dans ce studio, on peut remarquer le jeu de volumes propre à l’Art Déco (triangle, relief, carré, arrondi, etc…) Les murs sont lambrissés de bois précieux : acajou, limba, wengé.
Actuellement, on y donne des conférences. Il peut contenir +/- 200 places.
Studio n° 2
Il présente une forme trapézoïdale et est principalement destiné à la musique de chambre. Il est très bien isolé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ici aussi les murs sont recouverts de bois précieux.
Studio n° 4
Il s’agit du plus grand studio de la Maison de la Radio. C’est aussi celui qui a subi le plus de transformations : les sièges ont été refaits, le tapis plain enlevé, mais surtout, Philippe Samyn a dû augmenter la capacité de la salle, sans pour autant en changer l’acoustique. La solution apportée fut d’apposer des balcons suspendus, très légers et dont l’esthétique n’étouffait pas le reste de la salle. C’est dans ce studio que répétait l’orchestre de la R.T.B.F. et que venait fréquemment écouter la Reine Elisabeth. Actuellement, il n’y a plus de loge royale, ce qui est étonnant pour une salle de concert publique .Il mesure 1000 m2, a un volume de 15.000 m3, 900 places assises et une estrade qui peut accueillir 400 exécutants.
Il est à remarquer que les orgues n’ont jamais fonctionné, mais, avec le studio I, ce fut la restauration la plus coûteuse à cause du désamiantage.
Il y au total 19 studios, mais comme la restauration du bâtiment a pu être réalisée grâce principalement au mécénat, firmes importantes, banques etc., certains studios leurs sont réservés. Ils y organisent des concerts, récitals ou réceptions privées, nous n’y avons évidemment pas eu accès.
Bureau du directeur ou Salon Diongre
Cet espace présente un mobilier d’origine, très art déco. Il a une vue plongeante sur la place, malheureusement envahie de travaux, mais néanmoins très harmonieuse par la couleur choisie pour les briques des autres bâtiments qui se sont clairement inspirés de l’I.N.R. Au point de vue éclairage, les appliques lumineuses présentent un caractère original. Les néons sont fabriqués sur mesure et ont une forme particulière et originale.
Petit détail amusant, vis-à-vis du bureau directorial qui embrasse toute la Place Flagey, on remarque une petite enseigne de magasin Delhaize : ce fut le premier magasin libre-service de Belgique !
Le hall
Cet endroit montre que c’est là que la notion d’espace prend tout son sens. C’est un luxe de l’époque que de pouvoir imaginer la construction d’un tel hall et une aussi grande « perte d’espace ». Tout autour se trouvent des bureaux qui sont actuellement à louer. La décoration de ce lieu porte principalement, et ici aussi, sur les néons, le lion représentant la Belgique, l’horloge (détail présent dans tout le bâtiment pour des raisons évidentes de ponctualité) le puits de lumière qui, la nuit répercute les lumières à l’infini, ce qui donne une notion de grandeur inhabituelle.
La Maison de la Radio est un exemple magnifique de l’association de la technique et de l’esthétique. Longtemps, le studio 4 fut considéré comme étant le meilleur au monde. L’utilisation de l’Art Déco, l’espace perdu, utilisé à outrance ainsi que la franche inspiration de navires en font un des bâtiments les plus représentatifs d’une époque riche en nouveautés et en découvertes.
Repas pris dans un restaurant proche de la maison de la radio, mais un peu exigu pour recevoir notre groupe. En ville, c’est toujours le même problème : tenter de trouver un endroit qui ne soit pas trop éloigné du lieu de visite et pas trop loin pour que le chauffeur de car ne doive pas faire des kilomètres à pied pour garer et rechercher son véhicule.
Deuxième visite de la journée, le
Cimetière de Laeken.
Le cimetière de Laeken est le plus ancien des cimetières bruxellois, encore en activité, et le dernier en service autour d’une église.
A la fin du XVIIIe siècle, il est devenu un lieu de sépulture recherché par l’aristocratie, les artistes, les savants et les hommes politiques. Un grand nombre de personnalités y sont enterrées et l’on remarquera que certaines tombes ont un réel cachet artistique. D’abondantes plantations accentuent le caractère romantique de ce cimetière qui a ainsi été surnommé le « Père Lachaise » de Belgique.
Les origines de la paroisse et du cimetière de Laeken restent vagues. Des représentations du XVIIe siècle montrent l’église paroissiale Notre Dame du XIIIe siècle avec le cimetière plus ou moins circulaire qui l’enserre de près. Il n’y a pas de tombes visibles car à cette époque, les fosses sont communes.
En 1871, les gouverneurs généraux des Pays-Bas font transformer le domaine voisin de Schoonenberg en leur résidence d’été qui deviendra par la suite le château de Laeken. Ils donnèrent de la sorte une grande impulsion à la popularité croissante du cimetière local.
Par décret impérial du 26 juin 1784, Joseph II interdit d’enterrer encore dans les églises et ordonne l’aménagement de nouveaux cimetières en dehors des murs d’enceinte. De nombreux bruxellois préfèreront continuer à utiliser le cimetière paroissial de Laeken encore en sursis.
Par le décret de Napoléon, daté du douze juin 1804 chacun pourra se procurer une parcelle de terrain, individuelle, pour une durée indéterminée, ou concession à perpétuité, afin d’y ériger un monument : c’est le début du monumentalisme au cimetière de Laeken.
En 1831, Léopold Ier fait du château de Laeken sa résidence, puis la reine Louise Marie d’Orléans dont le souhait explicite est d’être inhumée dans l’église paroissiale de Laeken décède en octobre 1850. Le Parlement vote alors la construction d’une nouvelle et monumentale église mausolée, l’actuelle église néo-gothique Notre-Dame de Laeken, qui contient la crypte royale, tandis que l’ancienne église paroissiale sera désaffectée : le chœur est néanmoins conservé au centre du cimetière.
La présence royale au château de Laeken, la popularité de Louise-Marie, l’extension de la ville et
l’accroissement de la population expliquent les agrandissements successifs du cimetière de Laeken au cours du XIXe siècle.
La promenade fait découvrir entre 20 et 30 sépultures. Les unes possèdent un véritable attrait artistique et sont souvent représentatives des styles « néo » du XIXe siècle, à savoir : le classique, le gothique, le baroque et l’éclectique. Elles sont un véritable florilège de l’évolution des conceptions artistiques sur une période d’un siècle. D’autres peuvent n’avoir qu’un intérêt artistique limité, voire même inexistant, par contre la personnalité historique ou anecdotique de la personne inhumée peut être digne d’être rappelée ou découverte. Parlons de quelques unes d’entre elles :
- la sépulture de Marie Pleyel, originaire de la famille de pianistes du même nom : sa tombe présente plusieurs emblèmes musicaux.
- un monument funéraire réalisé par le sculpteur Cluysenaer était dédié à un ancêtre de la reine Paola.
- dans un autre monument gisent les restes de Wyns de Raucour qui fit installer l’eau à Bruxelles.
- le Général Belliard qui a combattu dans les batailles de Napoléon et qui a, comme plusieurs autres laissé son nom à une rue de Bruxelles, n’a qu’un cénotaphe : c'est-à-dire qu’un monument lui est consacré, mais ses restes n’y sont pas.
- la Malibran, célèbre cantatrice, morte très jeune après une vie sentimentale assez tumultueuse. D’origine espagnole, elle était née Garcia. L’entretien de sa tombe, monument à l’étrusque est à charge de la commune d’Ixelles.
- citons encore la tombe de l’architecte Alphonse Balat, qui a fait les plans des serres royales et du musée d’art ancien entre autres.
- un monument important, placé à l’une des entrées du cimetière représente le Penseur de Rodin et est dédié à Jef Dielens
- le monument des Khnopff, père et fils, le peintre dont nous sommes allés voir la rétrospective il y a peu à Bruxelles.
- on peut encore ajouter la tombe du Docteur Seutin qui a été l’inventeur du bandage constituant un plâtre, médecin du roi et professeur à l’U.L.B.
- enfin pour terminer, le mausolée de la famille Suys, l’architecte qui a voûté la Senne.
La tombe la plus ancienne du cimetière date de 1649 : elle contient les restes du doyen de l’époque, qui seul, avait droit à une pierre tombale, tous les autres défunts étant inhumés dans une fosse commune.
Notre guide a encore attiré notre attention sur les différents symboles, traditionnels qui ornent les tombes : les mains jointes, les chaînes brisées, le livre de la vie, la colonne brisée, sur certains emblèmes qui représentaient la profession de la personne inhumée.
Sous le cimetière, il y a des galeries souterraines que l’on ne visite pas, mais qui sont des sortes de catacombes.
Pour terminer la journée, nous avons été prendre un dernier petit repas à ce qui était autrefois la Belgique Joyeuse . Il y a beaucoup d’animations, surtout beaucoup de bruit et les crêpes étaient loin de valoir les crêpes de grand-mère, mais cela nous a rappelé pas mal de souvenirs. Il me semble qu’il y a déjà longtemps que nous avons eu 20 ans !!!