
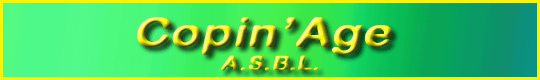
| Dernière mise à jour : 23/08/05 |

Andenne
Sauvenière, fin juin 2005.
Bonjour à tous et à toutes,
Notre excursion mensuelle nous a permit de découvrir la ville d’Andenne.
Ici, la Meuse se fait industrielle. Le travail de la chaux et de la pierre de taille blanchit la vallée.
Andenne conserve en ses fontaines ombragées et ses humbles chapelles le souvenir de Sainte Begge. Elle a son tombeau dans la collégiale, ainsi que Charles Martel qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732 et aussi celui de Berthe ou Bertrade dite Berthe au grand pied, femme de Pépin le Bref, mère de Charlemagne qui vint y finir ses jours en 783.
Andenne fut réputée dès le XII esiècle pour ses poteries et à partir du XVIII e pour sa porcelaine. Tout, ou presque, y est encore placé sous le signe de la céramique.
Le musée communal de la céramique, la piperie Léonard et l’atelier ne manquent pas d’intérêt.
La piperie familiale, traditionnelle du XVIII e siècle est le dernier atelier en Belgique où sont encore fabriquées des pipes de terre.
Moules originaux et outillage spécifique, démonstration de moulage et de décoration sont très intéressants à regarder.
Quant au musée de la céramique, on y découvre 19 siècles de céramique. Poteries du II e au XIV e siècle, lustre du XII e, pipes rares, faïence et porcelaine des XVIII e et XIX e siècles, tuiles et briques, fours, carrière d’argile, plan en relief d’Andenne, atelier de céramiste comblent notre curiosité.
Andenne, connue depuis l’époque romaine paya un lourd tribu à l’histoire. Sa situation en marge du Comté de Namur et de la principauté de Liège la plaça au cœur des conflits de la guerre de la Vache. Les troupes françaises, autrichiennes puis allemandes ont martyrisé la ville aussi bien dans sa pierre que dans la chair de ses habitants.
Petit rappel historique, ou comment un paisible ruminant mit toute une région à feu et à sang. C’est en 1273 que les tensions accumulées entre le comté de Namur et la principauté de Liège, deux puissances voisines et rivales, trouvèrent un prétexte pour se libérer. En ce temps là, en effet, Engoran, un paysan de Jallet, s’en alla essayer de vendre, au marché d’Andenne, une vache qu’il venait de voler à un bourgeois de Ciney. Ce geste allait mettre le feu aux poudres.
Reconnu par le volé et traîtreusement attiré sur le territoire du baillage de Ciney, Enrogan fut sommairement jugé et pendu sur le champ.
Le seigneur de Goesnes, dont dépendait Eurogan, profitant de cet incident, déclencha les hostilités, mais le bailli de Ciney et les sires de Celles et de Spontin répliquèrent avec vigueur. Bref, de fil en aiguille, durant deux ans, toute cette région, soit une cinquantaine de villages fut le théâtre de combats fratricides, victoires et défaites se succédant de part et d’autre. Massacres, pillages, incendies ne cessèrent qu’en 1275, à l’intervention du roi de France, Philippe III le Hardi.
Aujourd’hui encore, le souvenir de la guerre de la vache est ravivé par la vue des châteaux, églises et fermes fortifiées dont la région est parsemée. Ces magnifiques bâtiments témoignent de l’insécurité qui régnait au Moyen Age dans ces régions et dont la guerre de la vache n’illustre qu’un épisode.
Pourquoi l’ours est-il l’emblème d’Andenne ?
Parce que Charles Martel, que la tradition considère comme étant né à Andenne aurait, âgé seulement de neuf ans, tué un ours féroce à l’aide d’un marteau. La tradition en reste particulièrement vivante. Le dimanche de la mi-carême Andenne s’anime pour le carnaval des Ours, fête populaire qui commémore cet exploit. A la fin du spectacle, on jette du haut du balcon de l’hôtel de ville, des ours en peluche.
Première visite, la
Piperie Léonard.
D’emblée, Pascal Léonard, propriétaire de la piperie annonce la couleur. Sa passion, c’est la bouffarde, mais pas n’importe laquelle ! La vraie de vraie. La pipe en terre, celle qui a été façonnée avec doigté et amour dans l’argile, qui a une odeur, un passé, une histoire. Il n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure, même si aujourd’hui la fabrication est tout à fait désuète. Voici ce qu’il dit : « je suis le dernier pipier en activité dans le pays, mais je ne gagne pas un cent avec ça, la production est beaucoup trop maigre ». Il se consacre essentiellement à la céramique et à la poterie. Cela dit, son grand-père fabriquait des pipes en terre pour les fêtes foraines. Son père a poursuivi cette activité en mécanisant l’entreprise. Pascal a repris le flambeau. Mais cela va beaucoup plus loin que l’esprit de famille. Cette activité de pipier lui a permis et lui permet toujours de faire des chouettes rencontres. Les amateurs de pipes en terre sont en général des gens posés, très agréables, ce sont des passionnés d’histoire, des collectionneurs. Ils ont toujours des anecdotes à raconter.
En réalité, Pascal est un peu le dernier des Mohicans. Andenne a connu ses heures de gloire dans la seconde moitié du XVIII e siècle. A l’époque, une fabrique de pipes employait une centaine d’ouvriers. La matière première était de la terre à pipe, la blanche derle, renommée pour ses qualités essentielles. Coulée dans des moules métalliques, pour lui apporter texture et finesse, elle était ébarbée et retouchée à la main, avant d’être cuite à 1100 ° pour obtenir une solidité tout en gardant la porosité nécessaire au bon culottage.
Mais c’est quoi une bonne pipe en terre ? Quels sont ses atouts ? Sa qualité essentielle, c’est qu’elle respecte le goût, l’arôme du tabac.
Pascal a toujours éprouvé beaucoup de plaisir à travailler l’argile avant de la glisser dans un moule. Et là, ce n’est pas le choix qui manque : il y en a plus d’une centaine, allongés dans les tiroirs ou sur les étagères.
Trois pièces des anciens ateliers sont entièrement consacrées à la pipe en terre. Dans les vitrines, des centaines d’exemplaires. Des pièces souvent uniques, qui viennent des quatre coins du monde. En point de mire une vieille baraque foraine et un ancien tir aux pipes.
Parmi ses nombreuses activités, Pascal s’occupe de l’organisation d’un grand concours mis sur pied par le Pipe Club de Liège. Le principe pour tous les participants est le suivant : tenir un maximum de temps en ne bourrant qu’une seule fois le calumet. Au menu : trois grammes de tabac, pas un de plus, et trois allumettes. Certains parviennent à tenir plus d’une heure et demie, ce sont de véritables champions en la matière. Comme tous les passionnés, Pascal est intarissable, il est jovial, bon enfant. Plus insolite, sacré nom d’une pipe, il n’est pas fumeur !
Histoire de la pipe
Si la trace des premières pipes s’est perdue dans la nuit des temps, on suppose que tout a commencé par des inhalations à l’aide d’un os évidé. Devenue aujourd’hui un objet de collection, attachée à une personnalité comme Sherlock Holmes ou le capitaine Haddock, la pipe ne connut son heure de gloire qu’au XVII e siècle avec la commercialisation du tabac qui, pour Hippocrate, offrait un remède aux problèmes gynécologiques, et pour les Indiens, des vertus magiques à tel point que Louis XV leur commandera des pipes en forme de tomahawk pour remercier les chefs indiens d’avoir pris le parti de la France contre les Anglais de Montcalm.
Cependant, c’est à Christophe Colomb que l’on doit d’avoir introduit le tabac en Espagne et à Jean Bicot pour la France. Dix ans plus tard, le botaniste Liébault va associer son nom à la nouvelle plante qu’est la nicotine. La mode va ensuite s’en emparer, notamment à la Cour de Catherine de Médicis.
Du latin « pipa » (tuyau) la pipe va d’abord s’imposer comme pièce décorative avant de devenir utilitaire grâce à Sir Raleigh et à l’ouverture d’une fabrique dès 1575 en Angleterre. Cependant, elle a aussi eu ses adversaires pour qui son usage demeurait une coutume barbare.
Aujourd’hui, la pipe en terre a de nouveau le vent en poupe, suite notamment à une exposition qui s’est tenue à Andenne, en collaboration avec la piperie Léonard, où l’on pouvait constater que, en l’espace d’une centaine d’années, le volume du fourneau a augmenté, la fourniture de la matière première devenant plus facile.
C’est de 1758 que date l’arrivée des premiers pipiers à Andenne avec les allemands Mennicken et Hörter. Cependant, c’est à Désiré Barth que la ville doit sa renommée pour avoir exercé sa profession durant une trentaine d’années et en ayant à son actif une centaine de modèles. Si plusieurs fabriques existaient dans la région au siècle dernier, chacune d’elle fabriquant en moyenne cent mille pipes par jour, après la première guerre mondiale il n’en existera plus qu’une, la piperie Léonard qui, avec la ville d’Andenne, a accueilli le XV e congrès de l’Académie internationale de la pipe.
Au XVIII e siècle, les entreprises vont se multiplier, même si les fumeurs de pipes restaient insatisfaits étant donné que les matières utilisées chauffaient anormalement. En Hollande, Baernets ouvrit une manufacture à Gouda qui devint le principal centre de production européen. Les modèles dont la Gouvernaar, sa marque déposée, étaient de formes simples, à petit fourneau perpendiculaire ou incliné par rapport au tuyau. Afin de satisfaire tous les goûts, les artisans imaginèrent des pipes plus luxueuses, ornées de motifs de la marque du fabricant et du blason de la ville.
La domination de Gouda prit fin avec l’arrivée des firmes Fiolet à Saint Omer et Gambier à Givet que Rimbaud va immortaliser dans son « Oraison du soir ». Sa spécialité était la pipe sculptée à l’effigie de personnages dont « Jacob » vieillard barbu enrubanné à l’orientale, patriarche de la Bible et père des tributs d’Israël. Ce modèle a fait l’objet d’imitations ce qui lui vaut de posséder l’inscription « je suis le vrai Jacob » pour authentifier une pièce véritable. En 1868, la marque commercialisait près de cent mille pièces par jour déclinées en plus de deux mille modèles et inspirées de la vie de l’époque.
Source d’inspiration pour de nombreux artistes, dont Mondrian, et Magritte, la pipe a aussi servi de modèle à Courbet et à Renoir. Quant à la psychanalyse, elle s’est très tôt intéressée à l’instrument dès lors qu’il devint vite un objet usuel à connotation érotique. En Prusse, l’engouement fut tel que Frédéric I er organisa des soirées spéciales. Si Napoléon la recommandait à ses soldats, le général Lassale considérait qu’un hussard qui ne fume pas, était un mauvais soldat. Quant au pape Urbain VII quant à lui, il menaçait les fumeurs d’excommunication...
Parmi les progrès réalisés ces dernières années figure l’invention de la pipe à tuyau amovible, en merisier, où seul le fourneau était en terre. Objet fragile, la pipe en terre fut souvent remplacée par des pipes en fer, en argent ou en porcelaine qui étaient compliquées et insatisfaisantes du point de vue du goût mais évidemment beaucoup plus belles. La manufacture de Meissen trouva son artiste le plus inventif en la personne de Jean Gottlieb Ehder dont les œuvres valent aujourd’hui une fortune.
Côté français, la manufacture de Sèvres proposa plusieurs créations prestigieuses à l’effigie de Napoléon.
Si le verre et le marbre des modèles vénitiens connurent la prospérité, c’est néanmoins le bois, partout disponible et bon marché, qui obtint la cote, avec en particulier les pipes originaires de la ville d’Ulm, en orme, aux ornements en argent, munies d’un couvercle et d’une chaînette reliant la tête et le tuyau.
Il fallut attendre l’invention de la pipe de bruyère vers 1855, plus résistante à la chaleur, pour lancer les pipes de Saint Claude, dans le Jura, qui aujourd’hui sont vendues à près de sept cent mille exemplaires, mais l’arrivée de la cigarette et les campagnes contre le tabagisme vont faire chuter les ventes. C’est ainsi qu’en France, les cinq mille ouvriers travaillant dans le secteur pipier en 1925 sont passés à deux cents aujourd’hui.
Tout collectionneur vous dira que les plus belles pipes sont en écume de mer dont l’origine remonte à 1723 chez un certain Kovcas, à Budapest, où elle aurait été fabriquée pour le comte Andrassy qui rapporta le minéral en Turquie. Elle se répandit ensuite dans l’aristocratie, les plus beaux modèles étant munis de couvercle en argent, de tuyaux d’ambre ou sculptés de personnages. Ce qui se sait moins, c’est que les déchets sont réutilisés sous l’appelation d’écume de Vienne.
Cependant, la pipe de bruyère représente la quasi-totalité des ventes, suivies par les modèles en écume dont la matière reste rare et le prix élevé.
La demande des pipes haut de gamme est en hausse malgré la lutte des ligues anti-tabac.
La fabrication des pipes fait appel à un vocabulaire digne des meilleurs cruciverbistes puisqu’on y évoque notamment le « varlopage » et le « bobécannage ». Quant au fait main, il est l’œuvre d’artistes d’exception comme celle de Roger Vincent au musée de Bergerac en France. Composée d’ivoire et de rubis, elle est longue de quarante centimètres.
Si le danois Ivarsson est considéré comme le plus grand pipier du siècle, Alfred Dunhill serait le plus ancien avec la fondation d’une dynastie qui remonte à 1893.
En Belgique, la piperie Léonard a repris la production de pipes avec d’anciens moules. Elle propose plus de cent modèles représentant notamment des membres de la famille royale et des personnages mythologiques.
Après un délicieux repas pris dans le village de Coutisse, sur les hauteurs d’Andenne nous sommes redescendus dans la vallée mosane afin de visiter le musée de la céramique. Celui-ci rend hommage a cette autre spécialité andennaise.
Afin de comprendre cette fabrication peut-être faut-il expliquer les différences entre porcelaine, faïence , grès et céramique.
1° La porcelaine
La porcelaine est un produit céramique composé de kaolin, de quartz et de feldspath. La pâte doit au kaolin sa malléabilité et sa résistance au feu. Le feldspath et le quartz réduisent tant la flexibilité que la déformation au feu et à la sécheresse et servent de fondants.
Les matériaux doivent tous être très purs et surtout non ferreux.
Le kaolin brut, mou, terreux et légèrement friable est lavé à grande eau dans les moulins et conduit dans les lavoirs où il perd ses principales impuretés. La terre ainsi purifiée est amenée dans des bassins où les particules de kaolin se déposent doucement. Le feldspath et le quartz sont affinés dans des concasseurs et des broyeurs, puis réduits en poudre ou, par adjonction d’eau, en bouillie dans des moulins.
La bouillie de kaolin ainsi obtenue est mélangée aux deux autres ingrédients pulvérisés dans des proportions déterminées et le tout est intimement amalgamé. La pâte contient encore trop d’eau pour pouvoir être travaillée, c’est pourquoi on la filtre. On laisse alors reposer avant l’emploi la pâte ainsi obtenue, contenant encore 20 à 30 % d’eau, dans une cave humide, ce qui ajoute à sa plasticité. Lorsque le moment est venu de l’utiliser, on la fait passer dans une machine qui la bat, la presse et la pétrit pour en chasser les bulles d’air.
Pour donner sa forme à un objet on peut procéder par tournage, moulage ou coulage. On a recours au tournage pour les objets ronds ou plats, des assiettes par exemple. Il a lieu sur le tour. Le moulage est employé pour les objets les plus divers : figurines, mais aussi vases, terrines, bols. On fait d’abord un modèle en pâte malléable de l’objet à fabriquer. On fait à partir de ce modèle un moulage en plâtre que l’on coupe afin de pouvoir sortir les morceaux sans les casser. Dans ces moules, on verse la pâte sous forme de barbotine (c'est-à-dire étendue d’eau). Le plâtre absorbe une partie de l’humidité en sorte que la pâte subit un retrait de quelques millimètres. Après un moment, on fait tomber l’excédent de pâte et on ouvre les moules. Il faut alors remonter l’objet en suivant le modèle et reprendre les coutures à la barbotine afin de les rendre invisibles.
L’estampage, c’est-à-dire la fabrication au moyen de formes métalliques, est utilisé surtout pour des articles fabriqués en grande quantité et de façon uniforme quant à leurs mesures.
L‘on passe ensuite au séchage et à l’émaillage. Après le façonnage, la pièce est mise dans un endroit sec et soigneusement aéré pour y perdre son eau. Cette opération est très longue et doit être soigneusement menée afin d’éviter les fêlures. Les objets sont ensuite asséchés au four vers 800° pour leur donner un peu de solidité. Ils acquièrent ainsi une certaine porosité importante pour l’adhérence de l’émail..
Une seconde cuisson donne à la porcelaine ses propriétés caractéristiques. Les pièces émaillées sont mises dans des cazettes (étuis en terre réfractaire) afin de les protéger du contact direct de la flamme et de la fumée. Ici, la température monte jusque 1300 à 1400°... Au cours de la cuisson l’émail couvre l’objet d’une couche vitreuse brillante et dure.
Viennent ensuite les applications des différentes couleurs qui forment la décoration. Les objets sont à nouveau recuits mais à température moins élevée.
La dorure est la dernière application sur porcelaine. L’or est dissous dans de l’eau régale, réduit en poudre brune dans du vitriol de fer ; la poudre ainsi obtenue est mêlée à un fondant, broyée et posée comme une couleur sur couverte. La dorure prend au feu un ton ocre jaune qui devient brillant quand on le polit à l’agathe et mat quand on le frotte au papier de verre.
Un mot qui prête souvent à confusion est le mot biscuit. On pourrait croire que cela signifie deux cuissons. Il n’en est rien ! Le biscuit est une porcelaine laissée sans émail, très appréciée à cause de son aspect mormonisme et la netteté de ses contours.
2° La céramique
Céramique vient du grec kéramos qui désigne l’argile du potier. L’argile mélangée à l’eau donne une pâte plastique malléable que la cuisson rend solide et à peu près inaltérable.
Pour éviter la porosité de l’argile ou le changement de couleur, les potiers utilisent différents revêtements. Le plus simple est l’engobe, argile délayée dans de l’eau colorée ou non d’oxydes métalliques. Les glaçures ou vernis sont des enduits vitreux à base de silico-alcaline ou plombeuse qui cuisent à assez basse température et qui est incolore. Il existe également les couvertes qui sont à base de feldspath qui contient du kaolin, cuisent à haute température et font corps avec la poterie. Il s’agit ici d’une invention chinoise qui mène à la fabrication des grès et ensuite de la porcelaine.
Pour résumer tout cela, disons que l’ordre croissant va de la poterie pour les objets usuels, jarres, tuiles entre autres, le grès, les faïences, fines et ordinaires, la porcelaine dure et tendre.
L’objet en terre cuite, témoin des civilisations disparues est un fossile directeur, élément le plus caractéristique et le plus instructif dans un ensemble archéologique.
s
Suivant la composition et le traitement du matériau, la forme, les inscriptions et les décors, l’on peut déterminer une ère chronologique, une civilisation avec son mode de vie, ses us et coutumes et ses croyances.
3° La faïence
Si les principes de base sont les mêmes, signalons que la faïence est cuite à 900°. Elle peut être ordinaire ou fine.
4° reste le grès et la poterie pour des usages de construction, etc.…
Le musée d’Andenne recèle une très belle collection de porcelaines et pipes qui ont été réalisées à Andenne et environs voici des dizaines, voire des centaines d’années.
Pour clore cette intéressante journée, un petit goûter a été pris dans une accueillante auberge dans la riante vallée du Samson,
Merci à vous tous qui avez participé à cette escapade mosane et à bientôt,