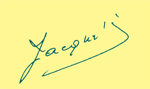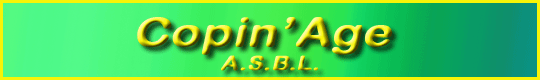
Dernière
mise à jour :
19/06/06
|
 2006
2006
Le château de Freyr et une ballade sur la Meuse
Sauvenière fin juin 2006.
Bonjour à tous,
Après des semaines de froid, de grisaille et de pluie, c’est sous un soleil radieux que s’est déroulée notre journée de détente mensuelle. La destination de notre excursion était, en but principal, Freyr. Ce fut une journée pleine de charme et de détente Après avoir pris un copieux petit déjeuner à Anseremme afin de prendre l’autre rive de la Meuse, nous sommes d’abord passés par
Dinant
Ville moderne mais de très ancienne tradition qui eut à souffrir dans sa chair et dans ses pierres tout au long de l’histoire. Cet étranglement de l’axe mosan fut l’objet de bien des convoitises !
Au XIe siècle la ville passa sous l’autorité des Princes Evêques de Liège. Alors débuta une période de luttes de quatre siècles contre la cité rivale de Bouvignes.
Le 27 août 1466, après des combats acharnés qui coûtèrent la vie à de nombreux Dinantais, la ville fut prise par Charles le Téméraire. Ce dernier, à la demande des Bouvignois fit précipiter dans le fleuve 800 Dinantais attachés deux par deux. Les Bourguignons disant à chaque fois « con on paire » le surnom de Copères serait resté aux Dinantais. En réalité, le travail du cuivre qui déjà au IXe siècle était connu et apprécié jusqu’à Cologne, a donné son nom aux habitants : koper ou kupfer, en langue germanique, devint « copère » en français.
Dinant connut encore d’autres vicissitudes mais un fait très connu est le massacre de 1914 connu sous le nom de « sac de Dinant » qui entraîna la mort de 674 civils, accusés par les Allemands d’avoir pris part aux combats. Parmi eux, des femmes, des vieillards et de très jeunes enfants. Plus de 75 % des habitations furent détruites par le feu.
Pendant la dernière guerre de nombreux combats vinrent à nouveau apporter la désolation dans la ville. Le pont, au cœur de la ville, est un objectif stratégique important depuis 1080, il a fallu le reconstruire en tout ou en partie une dizaine de fois. Le pont actuel date de 1953.
Au centre de Dinant s’élève la collégiale au clocher bulbeux couvert d’ardoises. Un rocher calcaire, à pic, couronné par la citadelle est son écrin.
Le rocher Bayard, au sud de la ville, escaladé par le roi Albert Ier en avril 1933, se dresse en sentinelle de la vallée. Tel un fer de lance, ce rocher aurait été brisé d’un coup de sabot par le Cheval Bayard, alors qu’il portait au-delà de la Meuse les Quatre Fils Aymon fuyant la colère de Charlemagne. Tant pis pour la légende : c’est Louis XIV qui fit creuser le passage par ses troupes.
Les célèbres couques de Dinant font la gloire des pâtissiers locaux par la finesse de leurs motifs, leur goût savoureux et leur résistance sous la dent !
N’oublions pas qu’à Dinant un personnage célèbre a vu le jour : Adolphe Sax. Son adolescence studieuse est marquée à vingt ans par une première invention : une clarinette à 24 clefs, suivie de peu d’une clarinette basse qui fait beaucoup parler d’elle dans les milieux musicaux. En 1840, il met au point et présente un nouvel instrument, celui auquel il donnera son nom : le saxophone.
Anseremme
où nous avons fait halte pour prendre un petit déjeuner est le point de départ de nombreuses promenades, Anseremme est aussi le terminus de la descente de la Lesse en kayak. Ce centre de villégiature est situé au confluent de la Meuse et de la Lesse.
Dans une boucle du fleuve, enfouit dans les arbres, on aperçoit un charmant prieuré du XVe siècle qui accueillit notre banquet, malheureusement sous une pluie battante, en 2001.
Les villas mènent leurs pelouses jusqu’au bord de la Meuse élargie et un chemin de halage s’étire le long de la berge, invitant à de paisibles promenades.
La Meuse
Plus longue que le Rhône ou la Seine, équivalent aux deux tiers du Rhin, la Meuse est certainement un des plus beaux fleuves d’Europe. Prenant sa source en France et se jetant dans la mer aux Pays-Bas, elle s’épanouit en Wallonie, au cœur des provinces de Namur et de Liège. La Meuse draine la vie humaine et constitue une voie d’échange depuis la nuit des temps.
L’époque romaine ne voit-elle pas le développement de la navigation et du transport des marchandises ?
Le Moyen Age s’organise en fiefs puis duchés, comtés et principautés. Les ambitions et luttes territoriales qui marquent cette époque se traduisent dans le paysage par l’édification de castels, places fortes et autres forteresses, souvent en des lieux stratégiques. Plus tard, au gré des circonstances, ces lieux dépourvus de confort évolueront vers des châteaux de plaisance ou passeront à l’état de ruines. Par ailleurs, quand s’ébaucheront les luttes entre nations, apparaîtront aussi des citadelles.
De la frontière française à la Basse Meuse qui amorce son entrée en Hollande, on suit donc le cours de l’histoire autant que le fil de l’eau.
Voici par ailleurs, une promenade sur la Meuse, racontée en 1868 par Théophile Gautier. « Est-il bien nécessaire pour qu’un voyage offre de l’intérêt, qu’il ait lieu dans des contrées lointaines, à demi fabuleuses, presque inaccessibles, où l’on ne va guère et d’où l’on ne revient pas souvent ? Notre idée n’est pas de déprécier les navigations sur le fleuve Amour, le Nil bleu ou blanc…mais une simple promenade sur la Meuse, de Charleville à Givet ou à Namur ne manque pas non plus de charme.
Non loin de Givet, on rencontre la frontière belge délimitée par un mince ruisselet. Le fleuve, sans se soucier des divisions géographiques, continue à couler entre des rives dont la droite est plus particulièrement escarpée et pittoresque. D’énormes rochers de formes tourmentées et bizarres dressent leurs cimes, tantôt dénudées, tantôt chevelues, avec des froncements et des rictus farouches. De larges crevasses, d’où les pluies ont emporté les terres désagrégées, sillonnent parfois, du sommet à la base, les rocs formidables et les isolent comme les tours et les remparts d’une forteresse démantelée. Il y a là de belles études à faire pour les peintres, et nous sommes étonnés que l’art n’ait pas mis à profit plus souvent ces superbes modèles qui tiennent si bien la pose et ne se font pas payer leurs séances.
Aux endroits moins abrupts, la végétation verdoie et les arbres se groupent par masses ou s’étendent en rideau. D’élégantes habitations, des maisons de plaisance, des châteaux s’élèvent sur le bord du fleuve, et, parmi eux, se fait remarquer la résidence princière de Monsieur le comte de Beaufort.
En suivant les méandres du courant, on arrive bientôt en face de la Roche à Bayard, une énorme aiguille de rocher dont le pied trempe dans l’eau et dont la cime est surmontée d’une girouette dorée, sans qu’on puisse trop comprendre comment on a pu l’aller planter là »
Voici maintenant atteint le but de notre première visite :
Le château de Freyr
Ce château se situe sur le territoire de Waulsort dans l’entité d’Hastière, dans une courbe de la Meuse, à peu près à mi-distance entre les villes de Dinant et de Givet. Le château se dresse à environ 4 Km au nord du village sur la N 96.
L’endroit où se dresse actuellement le château de Freyr, joyau de la Renaissance mosane, fut jadis occupé par une forteresse médiévale. Le choix du lieu fut dicté par la présence immédiate d’un gué : c’est la raison pour laquelle la forteresse fut construite dans la vallée et non pas sur un éperon rocheux comme ce fut le cas pour les autres châteaux mosans, tels Poilvache et Crèvecoeur.
La forteresse était la propriété des comtes de Namur, mais en 1378, le comte Jean offrit la seigneurie à Jean d’Orjo ou d’Orgeo suivant les sources, seigneur de Rochefort. En 1410, le domaine passa à une autre famille suite au mariage de Marie d’Orjo avec Jacques de Beaufort-Spontin. Freyr resta la propriété des Beaufort jusqu’en 1836, année du mariage de Gilda de Beaufort avec le comte Camille de Lambespin. Il appartient actuellement à la baronne Francis Bonaert, arrière petite-fille du comte Camille. Freyr n’a donc jamais fait l’objet d’une vente, ce qui est très rare pour ce type de propriété.
La Renaissance mosane y mélange harmonieusement la brique et la pierre et ses jardins à la française sont tout droit inspirés de le Nôtre.
Aménagement intérieur du château
L’intérieur du château est dominé par les styles Louis XV et Louis XVI. Seul le plafond du salon Louis XVI est de style Louis XIV. Le salon de Marie-Christine, gouvernante des Pays Bas du Sud et sœur de Marie Antoinette, reine de France, offre des lambris et des meubles de style Louis XVI. On peut également y admirer les portraits offerts par Marie-Christine lors de sa visite au château en 1785. C’est en prévision de cette visite que l’on construisit au milieu des jardins le célèbre pavillon de style Louis XV surmonté d’une coupole autrichienne. De la terrasse, on jouit d’une vue splendide sur les jardins. Ce pavillon est décoré de stucs des célèbres frères italiens Moretti. Le pavillon est aussi appelé « Frédéric Hall » en souvenir de Frédéric de Beaufort-Spontin. Le salon Louis XIV se distingue par sa cheminée en marbre de St. Remy. C’est dans ce salon que les délégués de Louis XIV et Charles II d’Espagne signèrent le 22 octobre 1675 le traité de commerce entré dans l’histoire sous le nom de « traité de Freyr ».
Le grand vestibule a gardé sa décoration du XVIIIe siècle. Le plafond peint reproduit les quartiers de noblesse des Beaufort-Spontin. Les parois du vestibules sont décorées de tableaux sortis de l’atelier du peintre anversois Snijders et ayant trait à la chasse.
La partie ancienne du château renferme la grande salle à manger dont les murs sont tendus de cuir de Cordoue.
Les célèbres jardins
Ces jardins font la fierté de Freyr. On y pénètre par une orangerie du XVIIIe siècle. Le très beau parterre qui précède le château ne compte pas moins de trente trois orangers, certains âgés de 300 ans, plantés dans des bacs ; sept pièces d’eau avec fontaines et quatre groupes de tilleuls plantés en carré. A Freyr, tout est basé sur la symétrie : l’on retrouve donc, toujours dans le même axe des charmilles taillées en forme de murets et tonnelles. On peut également admirer des labyrinthes inspirés par les quatre couleurs d’un jeu de cartes. Ces merveilleux jardins furent composés en 1760 par les frères Guillaume et Philippe de Beaufort-Spontin sous l’inspiration de Le Nôtre et avec l’aide de jardiniers compétents. Ces jardiniers amenèrent de Nancy les orangers achetés au roi Stanislas Leczinski, beau-père de Louis XV et dernier roi de Pologne. Ils font l’objet de soins attentifs et passent chaque hiver dans la chaleur des orangeries.
Les rochers de Freyr étant également la propriété de la famille, signalons que l’on trouve déjà le nom de Freyr dans des documents du XIe siècle. Au fil du temps, une légende s’est formée, mélangeant les divinités scandinaves, sans doute importées par les invasions normandes du IXe siècle et les nutons omniprésents dans le bassin de la Meuse.
Freya, déesse scandinave de la beauté poursuivait à travers le monde son mari Freyr, le principal dieu de la fertilité et de l’abondance qui avait sans doute fait une fugue. Elle s’arrête un jour dans une des grottes des bords de Meuse et y est capturée par une bande de nutons intéressés par l’argent qu’elle transporte. Elle s’endort mais ses dieux veillent. Le lendemain, tous les nutons sont morts. Depuis lors, les rochers ont gardé le nom de Freyr. Freya avait-elle enfin retrouvé son époux ? Comme on dit en Scandinavie ceci est une autre saga.
Les rochers de Freyr
Le site dans son ensemble dégage une harmonie exceptionnelle mariant aussi bien l’aspect sauvage des grises falaises avec l’air débonnaire du fleuve et sa maîtrise des lignes du château, l’agencement bien ordonné de ses jardins.
Après la visite du château et de ses jardins, nous poursuivons notre route le long de la Meuse en direction de
Hastière
ou deux villages unis par un pont :
- Hastière-par-delà, sur la rive droite, qui possède une splendide abbatiale de style roman dont la crypte contient des sarcophages mérovingiens, sa tour massive à l’allure de donjon qui domine la rive mosane et
- Hastière-Lavaux, au pied du Tienne d’Insemont, est un petit centre commercial actif.
Dans la vallée du Feron se trouve la grotte du Pont d’Arcole mise à jour par hasard en 1924 grâce à une fissure découverte au fond d’une carrière. Plusieurs niveaux superposés, abandonnés successivement par la rivière, donnent à cette caverne un très grand intérêt touristique et scientifique. Les concrétions sont très variées et leur abondance obstrue même complètement certaines galeries.
Après un délicieux repas, nous avons pris le bateau depuis Hastière et nous sommes redescendus au fil de l’eau jusqu’à Dinant où nous avons repris le car après une très agréable détente.